
Citations et Sagesses latines
A bove ante, ab asino retro, a stulto undique caveto : Prends garde au bœuf par devant, à l'âne par derrière, à l'imbécile par tous les côtés
Absentem lædit, qui cum ebrio litigat : Celui qui se querelle avec un ivrogne frappe un absent
Abusus non tollit usum : L'abus n'exclut pas l'usage
Abyssus abyssum invocat : L'abîme appelle l'abîme (Psaume de David)
Ad augusta per angusta : Vers les sommets par des chemins étroits (La gloire ne s'acquiert pas facilement)
Ad impossibilia nemo tenetur : À l'impossible nul n'est tenu
Ægroto dum anima est, spes est : Tant que le malade a un souffle, il y a de l'espoir
Amicus certus in re incerta cernitur : C'est dans le malheur qu'on reconnaît ses amis
Aquila non capit muscas : L'aigle ne prend pas les mouches
Audaces fortuna juvat : La fortune sourit à ceux qui osent
Audi, vide, tace, si tu vis vivere : Écoute, observe, et tais-toi, si tu veux vivre
Avaro omnia desunt, inopi pauca, sapienti nihil : À l'avare, tout manque, au pauvre, peu, au sage, rien
Barba non facit philosophum : La barbe ne fait pas le philosophe (l'habit ne fait pas le moine)
Beati pauperes spiritu : Bienheureux les pauvres d'esprit (citation extraite du Sermon sur la montagne)
Beatus qui prodest quibus potest : Heureux qui vient se rendre utile à ceux qu'il peut aider
Bis dat, qui cito dat : Donner rapidement, c'est donner deux fois
Bis repetita placent : Ce qui est répété séduit Bis repetita non placent : Ce qui est répété deux fois ne séduit plus
Bene diagnoscitur, bene curatur : Bien diagnostiquer, c'est bien soigner
Bona valetudo melior est quam maximæ divitiæ : Une bonne santé vaut mieux que les plus grandes richesses
Canis sine dentibus vehementius latrat : Un chien sans dents aboie plus vigoureusement (chien qui aboie ne mord pas)
Carpe diem : Cueille le jour (mets à profit le jour présent ; Horace)
Caveat emptor : Que l'acheteur soit vigilant
Cave ne cadas : Prends garde à la chute
Cibi condimentum est fames : La faim est l'épice de tout plat
Citius, Altius, Fortius : Plus vite, plus haut, plus fort ! (il s'agit de la devise olympique)
Cogito ergo sum : Je pense donc je suis (Descartes)
Consuetudinis vis magna est : La force de l'habitude est grande
Consuetudo altera natura est : L'habitude est une seconde nature
Contra vim mortis non est medicamen in hortis : Il n'y a dans le jardin aucun remède à la puissance de la mort
Contraria contrariis curantur : Les contraires se guérissent par les contraires
Cuiusvis hominis est errare : Il appartient à tout homme de se tromper
Dat veniam corvis, vexat censura columbas : La censure pardonne aux corbeaux et poursuit les colombes (Juvénal)
De gustibus et coloribus, non disputandum : Des goûts et des couleurs, il ne faut pas discuter
De mortuis nihil nisi bene : Des morts, on ne doit parler qu'en bien
Divide et impera : Divise pour régner
Dolus an virtus quis in hoste requirat ? : Ruse ou courage, qu'importe contre l'ennemi ?
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt : Le destin porte ceux qui l'acceptent et lynchent ceux qui le refusent
Dulce et decorum est pro patria mori : Il est doux et beau de mourir pour la patrie (Horace)
Dum spiro, spero : Tant que je respire, j'espère
Dura lex, sed lex : La loi est dure, mais c'est la loi
E fructu arbor cognoscitur : On connaît l'arbre par les fruits
Errare humanum est : L'erreur est humaine (Sénèque le Jeune)
Errare humanum est, sed perseverare diabolicum : Il est humain (dans la nature de l'homme) de se tromper, mais persévérer (dans l'erreur) est diabolique
Felix qui potuit rerum cognoscere causas : Heureux celui qui a pu pénétrer le fond des choses (Virgile)
Finis coronat opus : La fin justifie les moyens
Fortes fortuna juvat ou Audaces fortuna juvat : La fortune favorise les audacieux
Furor arma ministrat : La fureur fournit des armes
Gutta cavat lapidem non vi, sed sæpe cadendo : La goutte fait un trou dans la pierre, pas par la force, mais en tombant souvent
Habent sua fata libelli : Les livres ont leur propre destin
Hodie mihi, cras tibi : Aujourd'hui pour moi, demain pour toi
Homines quod volunt credunt : Les hommes croient ce qu'ils veulent croire
Homo homini lupus est : L'homme est un loup pour l'homme
Homo sum, humani nihil a me alienum puto : Je suis un homme ; rien de ce qui est humain ne m'est étranger (Térence)
Horas non numero nisi serenas : Je ne compte les heures que si elles sont sereines
Ignorantia iuris nocet : L'ignorance du droit porte préjudice
Ignorantia legis non excusat : L'ignorance de la loi n'est pas une excuse
Ignoti nulla cupido : On ne désire pas ce qu'on ne connaît pas (vers d'Ovide)
In cauda venenum : Dans la queue le venin
In dubio pro reo : Le doute profite à l'accusé (en cas de doute, on acquitte)
In medio stat virtus : La vertu se tient au milieu... et non aux extrêmes
Inter arma silent leges : En temps de guerre, les lois sont muettes
Ira furor brevis est : La colère est une courte folie
Iurare in verba magistri : Jurer par les paroles du maître
Iuventus stultorum magister : La jeunesse est le professeur des fous
Labor omnia vincit improbus : Le travail opiniâtre vient à bout de tout
Laborare est orare : Travailler, c'est prier (devise bénédictine)
Lacrimis struit insidias cum femina plorat : Lorsque la femme pleure, elle tend un piège avec ses larmes (Caton)
Macte animo ! Generose puer, sic itur ad astra : Courage noble enfant ! C'est ainsi que l'on s'élève vers les étoiles.
Major e longinquo reverentia : De loin, l'admiration est plus grande
Medicus curat, natura sanat : Le médecin soigne, la nature guérit
Memento mori : Souviens-toi que tu es mortel ou souviens-toi que tu mourras
Memento audere semper : Souviens toi de toujours essayer/oser
Memento quia pulvis es : Souviens-toi que tu es poussière
Mens sana in corpore sano : Un esprit sain dans un corps sain (Juvénal)
Multi sunt vocati, pauci vero electi : Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus
Mutatis mutandis : En changeant ce qui doit être changé ou en faisant les changements nécessaires
Natura abhorret a vacuo : La nature a horreur du vide
Nemo auditur propriam turpidudinem allegans : Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude
Nemo censetur ignorare legem : Nul n'est censé ignorer la loi
Nemo judex in causa sua : Nul ne peut être à la fois juge et partie
Neque ignorare medicum oportet quæ sit ægri natura : Il ne faut pas que le médecin ignore quelle est la nature de la maladie
Nihil lacrima citius arescit : Rien ne sèche plus vite qu'une larme
Nil novi sub sole : Rien de nouveau sous le soleil
Nil sine numini : Il n'y a rien sans la volonté des dieux
Nomen est omen : Le nom est un présage
Non nobis domine, non nobis nomine sed tuo da gloriam : Non pour nous Seigneur, non pour nous, mais en votre nom et pour votre gloire
Non omnia possumus omnes : Tous ne peuvent pas tout
Non scholæ, sed vitæ discimus : Nous n'apprenons pas pour l'école mais pour la vie
Non ut edam vivo, sed ut vivam edo : Je ne vis pas pour manger, mais je mange pour vivre
Non vestimentum virum ornat, sed vir vestimentum : Ce n'est pas l'habit qui embellit l'homme, mais l'homme qui embellit l'habit
Non vini vi no, sed vi no aquæ : Je ne nage pas grâce au vin, je nage grâce à l'eau (Jeu de mots)
Nondum amabam, et amare amabam : Je n'aimais pas encore, pourtant je brûlais d'envie d'aimer
Nosce te ipsum : Connais toi toi-même !
Nulla poena sine lege : Nulle peine sans loi
Nulla regula sine exceptione : Pas de règle sans exception
O tempora, o mores ! Ô temps, ô mœurs ! (Cicéron) : Autres temps, autres mœurs
Oculi plus vident quam oculus : Plusieurs yeux voient mieux qu'un seul
Oculos habent et non videbunt : Ils ont des yeux mais ne voient pas
Omne ignotum pro terribili : Tout danger inconnu est terrible
Omnes homines sibi sanitatem cupiunt, sæpe autem omnia, quæ valetudini contraria sunt, faciunt : Tous les hommes désirent leur propre santé mais ils agissent souvent contre elle
Omnes vulnerant, ultima necat : Les heures blessent toutes, mais la dernière tue
Omnia mea mecum porto : Je transporte avec moi tous mes biens
Omnia vincit amor : L'amour triomphe de tout Omnibus viis Romam pervenitur : Tous les chemins mènent à Rome
Omnis homo mendax : Tout homme est menteur
Omnium artium medicina nobilissima est : De tout les arts, la médecine est le plus noble
Optimum medicamentum quies est : Le meilleur médicament est le repos
Pax melior est quam iustissimum bellum : La paix est meilleure que la plus juste des guerres
Pecunia non olet : L'argent n'a pas d'odeur (Vespasien)
Plenus venter non studet libenter : À plein ventre l'étude n'entre
Plures crapula quam gladius perdidit : L'ivresse a causé la perte de plus de gens que le glaive
Post cenam non stare sed mille passus meare : Après dîner ne reste pas, mais va flâner mille pas
Præsente medico nihil nocet : Quand le médecin est là, pas de danger
Prævenire melius est quam præveniri : Précéder vaut mieux que d'être précédé
Primus inter pares : Le premier parmi ses pairs
Qualis pater, talis filius : Tel père, tel fils
Qui nescit dissimulare, nescit regnare : Qui ne sait dissimuler, ne sait régner
Qui rogat, non errat : Poser des questions n'est pas une erreur
Qui scribit, bis legit : Celui qui écrit lit deux fois
Qui tacet, consentire videtur : Qui ne dit mot semble consentir
Quia pulvis es et in pulverem reverteris : Parce que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière
Quidquid agis, prudenter agas, et respice finem ! : Quoi que tu fasses, fais-le avec prudence, sans perdre de vue la fin
Quidquid discis, tibi discis : Quoi que tu apprennes, tu l'apprends pour toi-même
Quis custodiet ipsos custodes ? : Qui gardera les gardiens ? (Juvénal)
Quo fata ferunt : Là où les destins l'emportent
Quod erat demonstrandum (Q.E.D.) : Ce qu'il fallait démontrer (CQFD) (Ponctue la fin d'une démonstration.)
Quod licet Iovis, non licet bovis : Ce qui est permis à Jupiter n'est pas permis au bœuf
Quod medicina aliis, aliis est acre venenum : Ce qui est un remède pour certains est poison violent pour d'autres
Quot capita, tot sententiæ : Autant d'avis différents que d'hommes
Reddite ergo quæ Cæsaris sunt Cæsari et quæ Dei sunt Deo : Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu
Repetitio est mater studiorum : La répétition est la mère des études
Requiescat in pace (R.I.P.) : Qu'il repose en paix
Sæpe morborum gravium exitus incerti sunt : Souvent, l'issue des maladies graves est incertaine
Salus ægroti suprema lex : Le bien-être du malade, voilà la loi suprême
Sapientia est potentia : La sagesse est pouvoir
Si napo leo viveret, hominem non esset : Si le lion vivait de navets il ne mangerait pas l'homme
Si tacuisses, philosophus mansisses : Si tu t'étais tu, tu serais resté un philosophe
Si vis pacem, para bellum : Si tu veux la paix, prépare la guerre
Si vis pacem, para iustitiam : Si tu veux la paix, prépare la justice
Sine labore non erit panis in ore : Sans travail il n'y aura pas de pain dans ta bouche, ou pour conserver le jeu de mots : Sans boulot, pas de fricot
Solem lucerna non ostenderent : On ne montre pas le soleil avec une lanterne (pour montrer l'évidence d'une chose)
Spoliatis arma supersunt : À ceux qui ont été dépouillés, une ressource reste : les armes
Tarde venientibus ossa : Pour les retardataires, des os. (se dit en parlant de ceux qui arrivent en retard à un repas)
Tempora mutantur et nos mutamur in illis : Le temps bouge, nous bougeons avec lui
Testis unus, testis nullus : Un seul témoin, pas de témoin
Ubi bene, ibi patria : La patrie est là où l'on se sent bien
Ubi concordia, ibi victoria : Là où il y a concorde, il y a victoire
Ubi lex non distinguit, non distinguere debemus : Là où la loi ne distingue pas, il ne faut pas distinguer
Ubi tu Gaius, ibi ego Gaia : Là où tu seras Gaïus, je serai Gaïa (formule de fidélité dite par les époux romains lors du mariage)
Ultima ratio regum : Le dernier argument des rois (devise inscrite sur les canons par ordre du Cardinal de Richelieu)
Ultra posse nemo obligatur : À l'impossible nul n'est tenu
Unum castigabis, centum emendabis : Si tu réprimes une erreur, tu en corrigeras cent
Usus magister est optimus : L'expérience [ou la pratique] est le meilleur maître
Ut ameris, amabilis esto : Pour être aimé, sois aimable
Ut sis nocte levis, sit cena brevis : Si tu veux passer une bonne nuit, ne dîne pas longuement
Vade retro satana : Retire-toi, Satan !
Vanitas vanitatum et omnia vanitas : Vanité des vanités, tout est vanité (Cri de l'Écclésiaste)
Veni vidi vici : Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu (Phrase de Jules César)
Verba docent, exempla trahunt : Les mots enseignent, les exemples entraînent
Verba volant, scripta manent : Les paroles s'envolent, les écrits restent
Veritas odium parit : La franchise engendre la haine (équivaut à l'actuel « Toute vérité n'est pas bonne à dire »)
Veritas odium parit, obsequium amicos : La franchise crée des ennemis, la flatterie des amis
Victrix causa diis placuit, sed victa Catoni : La cause du vainqueur a séduit les dieux, mais celle du vaincu a séduit Caton (Lucain, Pharsale, I, 128)
Vide supra : Voir plus haut
Video meliora proboque deteriora sequor : Je vois le bien, je l'aime et je fais le mal
Vinum aqua miscere : Mettre de l'eau dans son vin
Virtus post nummos : La vertu après l'argent Vox populi vox dei : La voix du peuple est la voix de Dieu
V.S.L.M abréviation de « Votum Solvit Libens Merito » : Il s'est acquité de son vœu, de bon gré, comme il se doit.
Vulnerant omnes, ultima necat : Toutes blessent, la dernière tue (adage sur les cadrans solaires)"
Proverbes latins
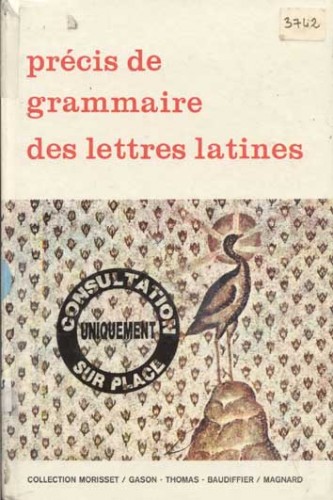
 -Quod natura non dat, Salmantica non docet (lo que no se tiene por naturaleza ni siquiera Salamanca lo puede enseñar: no se pueden pedir peras al olmo, o sea, cada mollera tiene sus limitaciones).
-Quod natura non dat, Salmantica non docet (lo que no se tiene por naturaleza ni siquiera Salamanca lo puede enseñar: no se pueden pedir peras al olmo, o sea, cada mollera tiene sus limitaciones).




 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg Greek tragedy is all but forgotten in mainstream culture, but there is a very good reason for looking at it again with fresh eyes. The reasons for this are manifold, but they basically have to do with anti-materialism and the culture of compression. To put it bluntly, reading Greek tragedy can give literally anyone a crash course in Western civilization which is short, pithy, and terribly apt.
Greek tragedy is all but forgotten in mainstream culture, but there is a very good reason for looking at it again with fresh eyes. The reasons for this are manifold, but they basically have to do with anti-materialism and the culture of compression. To put it bluntly, reading Greek tragedy can give literally anyone a crash course in Western civilization which is short, pithy, and terribly apt.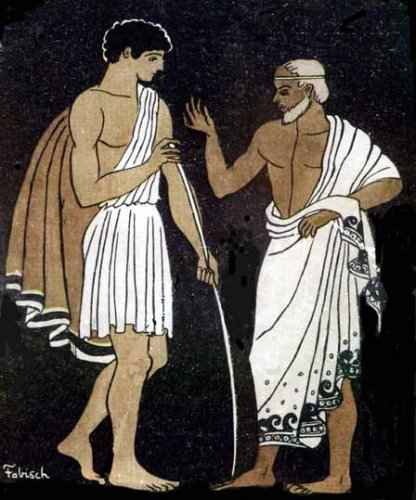







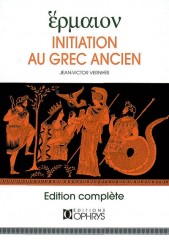 D’abord, il est indispensable de faire justice à une illusion. Un coup de sonde dans les quarante dernières années suffit pour cela. En quoi l’enseignement du latin et du grec a-t-il pu contribuer en quoi que ce soit à l’approfondissement de la culture, sinon à sa défense ? Les élèves qui sont passés par cette étape scolaire, certes en soi passionnante, ne se sont pas singularisés dans la critique d’une modernité qui se présente comme une guillotine de l’intelligence. Ils ont suivi le mouvement. Il est presque normal que ce pôle d’excellence ait été emporté, comme tout le reste, par la cataracte de néant qui ensevelit notre civilisation. Il aurait pu servir de môle de résistance, mais il aurait fallu que la classe moyenne fût d’une autre trempe. Car est-il est utile aussi d’évoquer les professeurs de latin et de grec qui, sauf exceptions (soyons juste) ne sont pas différents des autres enseignants ? Ils possèdent, comme chacun, leur petit pré carré, leurs us et coutumes, leurs intérêts, et, généralement, partagent les mêmes illusions politiquement correctes, ainsi qu’un penchant à profiter (comme tout le monde, soyons juste !) de la société de consommation. Faire des thèmes et des versions contribue à renforcer la maîtrise intellectuelle et langagière, certes, mais cela suffit-il à la pensée ? Ne se référer par exemple qu’à la démocratie athénienne, pour autant qu’elle soit comprise de façon adéquate, ce qui n’est pas certain dans le contexte mensonger de l’éducation qui est la nôtre, c’est faire fi de Sparte (victorieuse de la cité de Périclès), de l’opinion de quasi tous les penseurs antiques, qui ont méprisé la démocratie, de l’idéologie monarchique, apportée par Alexandre et les diadoques, consolidée par le stoïcisme et le néoplatonisme, et qui a perduré jusqu’aux temps modernes. Il faut être honnête intellectuellement, ou faire de l’idéologie. De même, la Grèce et la Rome qu’ont imaginées les professeurs du XIX
D’abord, il est indispensable de faire justice à une illusion. Un coup de sonde dans les quarante dernières années suffit pour cela. En quoi l’enseignement du latin et du grec a-t-il pu contribuer en quoi que ce soit à l’approfondissement de la culture, sinon à sa défense ? Les élèves qui sont passés par cette étape scolaire, certes en soi passionnante, ne se sont pas singularisés dans la critique d’une modernité qui se présente comme une guillotine de l’intelligence. Ils ont suivi le mouvement. Il est presque normal que ce pôle d’excellence ait été emporté, comme tout le reste, par la cataracte de néant qui ensevelit notre civilisation. Il aurait pu servir de môle de résistance, mais il aurait fallu que la classe moyenne fût d’une autre trempe. Car est-il est utile aussi d’évoquer les professeurs de latin et de grec qui, sauf exceptions (soyons juste) ne sont pas différents des autres enseignants ? Ils possèdent, comme chacun, leur petit pré carré, leurs us et coutumes, leurs intérêts, et, généralement, partagent les mêmes illusions politiquement correctes, ainsi qu’un penchant à profiter (comme tout le monde, soyons juste !) de la société de consommation. Faire des thèmes et des versions contribue à renforcer la maîtrise intellectuelle et langagière, certes, mais cela suffit-il à la pensée ? Ne se référer par exemple qu’à la démocratie athénienne, pour autant qu’elle soit comprise de façon adéquate, ce qui n’est pas certain dans le contexte mensonger de l’éducation qui est la nôtre, c’est faire fi de Sparte (victorieuse de la cité de Périclès), de l’opinion de quasi tous les penseurs antiques, qui ont méprisé la démocratie, de l’idéologie monarchique, apportée par Alexandre et les diadoques, consolidée par le stoïcisme et le néoplatonisme, et qui a perduré jusqu’aux temps modernes. Il faut être honnête intellectuellement, ou faire de l’idéologie. De même, la Grèce et la Rome qu’ont imaginées les professeurs du XIX Uno degli aspetti più caratterizzanti nello studio dell’Iliade e dell’Odissea è la scoperta delle modalità da parte di tutti i personaggi che hanno un rilievo narrativo, di “entrare” in se stessi e di dialogare non solo con gli dèi che si svelano in ogni aspetto dell’accadere umano, ma anche di scrutare i propri sentimenti, di “guardare” il vasto mondo che si muove nella vita interiore. E’ una realtà particolare, non facilmente rinvenibile in altre
Uno degli aspetti più caratterizzanti nello studio dell’Iliade e dell’Odissea è la scoperta delle modalità da parte di tutti i personaggi che hanno un rilievo narrativo, di “entrare” in se stessi e di dialogare non solo con gli dèi che si svelano in ogni aspetto dell’accadere umano, ma anche di scrutare i propri sentimenti, di “guardare” il vasto mondo che si muove nella vita interiore. E’ una realtà particolare, non facilmente rinvenibile in altre La prospettiva politica di
La prospettiva politica di 